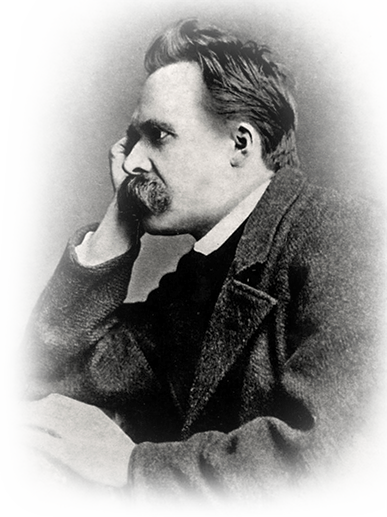[MA-VM-26]
De la plus intime expérience du penseur
Rien n’est plus difficile pour un homme que de saisir une chose d’une façon impersonnelle: je veux dire d’y voir précisément une chose et non pas une personne: on peut même se demander si, d’une façon générale, il lui est possible de suspendre, ne fût-ce que pendant un instant le mécanisme de son instinct qui crée et imagine des personnes. Dans ses rapports avec les pensées, même les plus abstraites, il se comporte comme si elles étaient des individus avec lesquels on est forcé de lutter ou de prendre partie, des individus que l’on garde, soigne et élève. Écoutons ou guettons-nous nous-mêmes dans la minute où nous entendons ou trouvons un axiome nouveau pour nous. Peut-être nous déplaît-il parce qu’il se présente avec tant de hauteur et d’orgueil: inconsciemment nous nous demandons si nous ne devons pas lui opposer un ennemi ou bien lui adjoindre un « peut-être » ou un « parfois »; le petit mot « probable » nous donne même satisfaction, parce qu’il brise la tyrannie personnelle de l’absolu qui nous importune. Lorsque, par contre, cet axiome nouveau nous apparaît sous une forme plus atténuée, tolérant et humble comme il convient, se jetant, en quelque sorte, dans les bras de la contradiction, nous avançons un autre exemple de notre souveraineté: car comment saurions-nous ne pas venir en aide à cet être faible, le caresser et le nourrir, lui donner de la force et de la plénitude et même une apparence de vérité et d’absolu? Nous est-il possible de nous comporter à son égard d’une façon naturelle, chevaleresque ou compatissante? — Ailleurs encore nous voyons d’une part un jugement et d’autre part un autre jugement, éloignés l’un de l’autre, sans qu’ils soient liés et sans qu’ils tendent à se rapprocher: alors une idée nous chatouille, nous nous informons s’il n’y aurait pas un mariage à faire, une conclusion à tirer, nous avons le sentiment vague qu’au cas où cette conclusion aurait une suite l’honneur en reviendrait non seulement aux deux jugements unis par le mariage, mais encore à l’auteur de ce mariage. Si, par contre, on ne peut s’attaquer à cette idée ni par l’entêtement et le mauvais vouloir, ni par la bienveillance (si on la tient pour vraie —), on s’y soumet, et on lui rend hommage comme à un guide et un chef, on lui accorde une place d’honneur et on n’en parle pas sans pompe et fierté; car son éclat rejaillit sur vous. Malheur à celui qui voudrait l’obscurcir ! Mais il arrive aussi que cette autorité devienne un jour scabreuse pour nous: — alors, nous qui sommes des infatigables faiseurs de rois (king-makers) dans le domaine de l’esprit, nous chassons du trône l’idée élue et y élevons en hâte son adversaire. Considérez cela et faites un pas de plus dans votre pensée: certes, personne ne parlera plus d’un « besoin de connaissance en soi » ! Pourquoi donc l’homme préfère-t-il le vrai au non vrai, dans cette lutte secrète avec les idées-personnes, dans ce mariage des idées, mariage demeuré le plus souvent caché, dans cette fondation d’États sur le domaine de la pensée, dans cette éducation et cette assistance de la pensée? Pour la même raison qui lui fait rendre justice dans ses rapports avec des personnes véritables: maintenant par habitude, héritage et éducation, primitivement parce que le vrai — comme aussi l’équitable et le juste — est plus utile et rapporte plus d’honneurs que le non-vrai. Car, dans le domaine de la pensée, il est difficile de maintenir la puissance et la réputation, lorsque celles-ci s’édifient sur l’erreur et le mensonge: le sentiment qu’un pareil édifice pourrait s’effondrer une fois est humiliant pour la conscience de son architecte; l’architecte a honte de la fragilité de son matériel, et, parce qu’il se considère lui-même comme plus important que le reste du monde, il ne voudrait rien exécuter qui ne fût plus durable que le reste du monde. Dans son désir de la vérité, il embrasse la foi en l’immortalité personnelle, c’est-à-dire la pensée la plus orgueilleuse et la plus altière qu’il y ait, car elle est liée intimement à l’arrière-pensée « pereat mundus, dum ego salvus sim ! » Son œuvre est devenue pour lui son ego, il se transforme lui-même en une chose impérissable, qui affronte toute autre chose; c’est sa fierté incommensurable qui ne veut se servir, pour son œuvre, que des pierres les meilleures et les plus dures, donc de vérités, ou de ce qu’il tient pour tel. À bon droit, on a de tous temps appelé l’orgueil « le vice de ceux qui savent », — mais la vérité et son prestige seraient en mauvaise posture, sur la terre, sans ce vice fécond. C’est dans le fait que nous craignons nos propres idées, nos propres paroles, mais aussi que nous nous y vénérons nous-mêmes, leur attribuant involontairement la faculté de pouvoir nous récompenser, nous mépriser, nous louer et nous blâmer, donc dans le fait que nous sommes en relation avec elles, comme avec des personnes libres et intellectuelles, des puissances indépendantes, d’égal à égal — c’est dans ce fait que le singulier phénomène que j’ai appelé « conscience intellectuelle » a ses racines. C’est donc encore une chose morale, d’un ordre supérieur, qui est sortie d’une racine vulgaire.